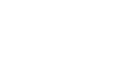Trauma : quand le mot devient un refuge plutôt qu’une réponse
T’as déjà remarqué ? Le mot « trauma » est partout. Dans les discussions, sur les réseaux, dans la bouche des gens qui cherchent à expliquer pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils n’arrivent pas à avancer, pourquoi ils se sentent bloqués. Et je comprends. Vraiment. Parce que mettre un mot sur ce qui nous échappe, c’est rassurant. Ça donne l’impression qu’on comprend enfin ce qui se joue à l’intérieur.
Sauf que.
Sauf qu’aujourd’hui, le trauma est devenu une explication fourre-tout. Une étiquette qu’on colle sur toutes nos peurs, toutes nos faiblesses, toutes nos réactions qui nous dépassent. Et dans cette confusion, on perd de vue ce qu’est vraiment un traumatisme psychologique. On dilue sa réalité. On banalise l’expérience de ceux qui ont réellement été effroyés jusqu’au fond de l’âme.
Alors avant de te bousculer, laisse-moi te tendre la main. Parce que si tu te poses la question, c’est que tu cherches à comprendre. Et c’est déjà énorme.
Ce qu’un trauma n’est pas
Commençons par poser les choses clairement. Un mauvais souvenir, ça n’est pas forcément un trauma. Une déception amoureuse, un échec professionnel, une dispute violente avec tes parents, un moment de honte qui te poursuit : oui, ça laisse des traces. Oui, ça fait mal. Oui, ça peut créer des croyances limitantes qui vont te pourrir la vie pendant des années.
Mais un trauma, c’est autre chose.
Le psychologue Pierre Janet, un des pionniers dans l’étude du traumatisme psychologique, parlait d’une « effraction ». Une intrusion brutale dans ta psyché qui dépasse complètement ta capacité à gérer.
Un événement où ton cerveau se retrouve sidéré, incapable de traiter l’information, incapable de donner du sens. C’est une confrontation directe avec la menace vitale : ta mort, celle d’un proche, ou l’anéantissement de ton intégrité physique ou psychique.
Tu vois la différence ?
Il ne s’agit pas juste d’avoir pris un coup. Il s’agit d’avoir été dépassé au point que ton système nerveux n’a plus su comment réagir. Au point que ton cerveau a créé une sorte d’anesthésie psychique pour te protéger sur le moment. Parce que c’était trop. Parce que c’était irreprésentable.
Les signes qui ne trompent pas
Alors comment savoir si tu as réellement vécu un traumatisme ? Pas en faisant un diagnostic toi-même sur Internet à trois heures du matin. Mais en observant ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête. Parce qu’un vrai trauma laisse des traces très spécifiques.
Les reviviscences d’abord. Ce ne sont pas de simples souvenirs. C’est cette sensation terrifiante de revivre la scène comme si elle se déroulait maintenant. Les flashbacks qui t’envahissent sans prévenir. Cette odeur, ce bruit, cette image qui te replonge instantanément dans l’horreur. Et tu n’as aucun contrôle dessus. C’est ta mémoire traumatique qui se réactive, piégée dans ton amygdale, incapable d’être traitée correctement par ton hippocampe.
L’évitement ensuite. Et pas n’importe lequel. Tu vas inconsciemment (ou très consciemment) tout faire pour échapper à ce qui pourrait te rappeler l’événement. Tu changes de trajet. Tu refuses certaines situations. Tu t’enfermes dans des stratégies d’évitement qui vont jusqu’à rétrécir complètement ton espace de vie. Parce que ton cerveau a décidé que le danger était partout.
L’hypervigilance aussi. Tu es constamment sur le qui-vive. Ton système nerveux est en alerte permanente. Tu sursautes pour un rien. Tu scrutes ton environnement comme si la menace allait resurgir à tout moment. C’est épuisant. C’est invivable. Mais tu ne peux pas t’en empêcher.
Et puis il y a les autres signes : les troubles du sommeil qui te bouffent, l’irritabilité qui explose sans raison, la dissociation qui te coupe de toi-même, l’amnésie qui troue ta mémoire, la dépression qui s’installe comme une chape de plomb.
Selon une étude menée par le Centre de ressources en traumatisme du Canada, environ 32% des personnes ayant vécu un événement traumatique développent une amnésie traumatique partielle. Leur cerveau a littéralement mis certains souvenirs sous clé pour les protéger.
Tous les traumas ne se ressemblent pas
Le psychiatre Bessel van der Kolk, qui a consacré sa carrière à l’étude du trauma, distingue plusieurs types de traumatismes. Et c’est important de le savoir, parce que ça va influencer ta manière de te reconstruire.
Il y a le trauma de type I : l’événement unique. L’accident de voiture, l’agression, la catastrophe naturelle. Un choc brutal qui crée une rupture nette entre un avant et un après.
Puis le trauma de type II : les événements répétés. Les violences intrafamiliales, le harcèlement, les abus. Ces traumas-là s’installent insidieusement et créent ce qu’on appelle un trauma complexe. Ils ne laissent pas juste une blessure, ils modifient profondément ta manière d’être au monde, ta capacité à faire confiance, ton sentiment de sécurité intérieure.
Et ce qui est essentiel à comprendre, c’est que l’intensité du trauma ne se mesure pas à l’événement lui-même, mais à ta réaction face à cet événement. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en ressortir différemment. Parce que tout dépend de ton histoire, de ta vulnérabilité du moment, de tes ressources internes, du soutien que tu as reçu après.
Ça ne veut pas dire que tu es faible si tu développes un stress post-traumatique. Ça veut dire que tu as été confronté à quelque chose qui a dépassé tes capacités de gestion sur le moment. Point.
Alors, c’est un trauma ou pas ?
Si tu te reconnais dans ces lignes, si ces symptômes résonnent en toi depuis des semaines, des mois, des années même, il est temps de consulter. Pas pour coller une étiquette. Pas pour te victimiser. Mais pour te donner les outils de te reconstruire.
Parce qu’un trauma non traité, ça ne disparaît pas tout seul. Ça s’enkyste. Ça se transforme. Ça contamine ta vie entière. Tes relations, ton travail, ta capacité à ressentir du plaisir, ta confiance en toi, ton alignement avec tes valeurs.
La Haute Autorité de Santé recommande une prise en charge précoce par des thérapies centrées sur le trauma, comme l’EMDR ou les thérapies cognitivo-comportementales. Ces approches ont fait leurs preuves. Elles permettent de retraiter les souvenirs traumatiques, de les réintégrer dans ta mémoire de manière moins envahissante, de retrouver un sentiment de sécurité.
Reprendre le contrôle, pas juste mettre un mot
Écoute, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as vécu ou pas. Je ne suis pas dans ta tête, je ne connais pas ton histoire. Mais ce que je veux, c’est que tu arrêtes de chercher des excuses ou des explications toutes faites à ce qui te bloque.
Si tu as vécu un vrai traumatisme, tu as besoin d’aide. D’un accompagnement sérieux, bienveillant, structuré. Pas d’auto-diagnostic sur les réseaux sociaux.
Si ce que tu as vécu n’est pas un trauma au sens clinique du terme, mais que ça te fait quand même mal, que ça t’empêche d’avancer, c’est tout aussi légitime. Tu as le droit de souffrir. Tu as le droit de vouloir que ça change. Et tu as aussi le droit de prendre la responsabilité de ta reconstruction, sans te cacher derrière un mot qui ne te correspond peut-être pas.
Parce que comprendre ce qui t’est arrivé, c’est le premier pas. Mais ce n’est qu’un pas. Le chemin, c’est toi qui le fais. Avec tes ressources, ton courage, ta résilience. Et parfois, avec l’aide d’un professionnel qui saura te tendre la main au bon moment.
Tu n’as pas à porter seul ce qui te pèse. Mais tu as à endosser ta responsabilité dans ta guérison. Et ça, personne ne peut le faire à ta place.
Avance.