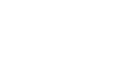Le mensonge intérieur : quand ton corps parle une langue étrangère
Tu dis que tu vas bien. Tu le répètes. Tu le crois presque.
Mais ton ventre se tord. Tes épaules pèsent. Ta mâchoire se crispe. Et quand on te demande « Qu’est-ce qui ne va pas ? », tu restes là, bouche ouverte, sans mots. Pas parce que tu ne veux pas répondre. Parce que tu ne sais pas.
Tu confonds la fatigue avec la tristesse. La colère avec le vide. L’angoisse avec une simple accélération du rythme cardiaque. Tu vis dans un brouillard émotionnel permanent, où tout se mélange, où rien n’a de nom.
Bienvenue dans l’enquête la plus déroutante que tu auras à mener : celle où tu découvres que tu ne parles plus la langue de tes propres émotions. Où ton corps hurle, mais ta tête reste silencieuse. Où tu fonctionnes, tu gères, tu tiens… mais tu ne ressens plus rien de clair.
Ce que tu vis porte un nom. Un nom que peu de gens connaissent, mais qui concerne 10 à 15% de la population : l’alexithymie. Littéralement, « l’absence de mots pour qualifier les émotions« . Ou comme le disait le psychiatre Peter Sifneos, celui qui a nommé ce phénomène dans les années 70 : une « aphasie émotionnelle ».
Tu n’es pas fou·folle. Tu n’es pas insensible. Tu es juste déconnecté·e de ton propre ressenti. Et aujourd’hui, on va enquêter ensemble pour comprendre pourquoi.
Quand les émotions disparaissent sans laisser de traces
Les indices que tu ignores depuis trop longtemps
Tu te reconnais dans ces scènes ?
Scène 1 : La question impossible
Quelqu’un te demande : « Comment tu te sens ? » Et tu bloques. Tu cherches. Tu dis « Fatigué·e », « Pas terrible », « Ça va ». Mais au fond, tu ne sais pas.
Scène 2 : Le corps parle, la tête se tait
Ton cœur s’emballe. Tu transpires. Tes mains tremblent. Mais tu ne sais pas si c’est de la peur, de la colère ou de l’anxiété. Tu identifies les sensations corporelles (la tachycardie, les bouffées de chaleur, les tremblements), mais tu n’arrives pas à faire le lien avec une émotion.
Scène 3 : L’événement majeur sans réaction
Un deuil. Une séparation. Une perte d’emploi. Les autres pleurent, craquent, explosent. Toi, tu restes impassible. Tu racontes les faits. De manière monotone. Avec un affect plat. Et les gens te regardent bizarrement, comme si tu étais insensible.
Scène 4 : L’empathie qui ne vient pas
Quelqu’un te confie sa douleur. Tu entends les mots. Tu vois les pleurs. Mais tu ne ressens rien. Pas par méchanceté. Tu ne déchiffres pas l’émotion impliquée. Tu ne sais pas quoi dire. Alors tu te tais. Et on te reproche ton manque d’empathie.
Si ces scènes te parlent, tu es peut-être alexithymique sans le savoir.
Le diagnostic silencieux
L’alexithymie, ce n’est pas un trouble mental officiellement reconnu dans le DSM-5. Ce n’est pas une maladie. C’est un trait de personnalité, ou dans certains cas, un état post-traumatique.
Olivier Luminet, professeur de psychologie des émotions à l’UCLouvain et chercheur de référence sur ce sujet, le dit clairement : « Il s’agit d’un problème de décodage des signaux d’informations entre le ressenti corporel et le niveau conscient. »
En clair : ton corps ressent. Mais ton cerveau ne traduit pas.
Le bouillonnement intérieur peut être très intense. Mais le visage reste impassible et les mots sont inexistants.
Mathieu, 41 ans, consultant en gestion, m’a raconté un jour : « Quand ma mère est morte, je suis resté de marbre. Les gens me prenaient pour un monstre. Mais je ne savais juste pas ce que je ressentais. J’avais mal au ventre, je dormais mal, mais je ne comprenais pas que c’était de la tristesse. »
Pourquoi tu as perdu la langue des émotions
Piste n°1 : L’enfance sous surveillance
L’alexithymie primaire (celle qui est un trait de personnalité stable) trouve souvent ses racines dans l’enfance.
La maltraitance infantile, la négligence émotionnelle, la violence psychologique : toutes les études convergent. Quand un enfant grandit dans un environnement où ses émotions ne sont pas nommées, accueillies, validées, il n’apprend jamais à les identifier.
Au stade préverbal, l’enfant ressent tout par le corporel. Ensuite, il apprend à nommer ce qu’il ressent. Mais si personne ne l’aide à mettre des mots, il reste coincé dans le somatique.
Comme Léa, 38 ans, qui m’a confié : « Petite, quand je pleurais, ma mère me disait ‘Arrête, tu n’as aucune raison d’être triste.’ Alors j’ai arrêté. J’ai arrêté de ressentir. »
L’alexithymie devient alors un mécanisme de défense. Une protection psychique pour ne pas ressentir des émotions trop difficiles.
Piste n°2 : Le traumatisme qui a tout coupé
L’alexithymie secondaire surgit après un traumatisme psychique ou physique (comme un traumatisme crânien).
C’est une déconnexion émotionnelle brutale. Un jour, tu ressentais. Le lendemain, plus rien.
Spinoza l’aurait dit autrement : « C’est l’esprit qui décide de ce qui est inquiétant. » Ton mental a pris le contrôle. Il a coupé l’accès aux émotions pour te protéger. Mais en te protégeant, il t’a aussi coupé de toi-même.
Sophie, 44 ans, a vécu un accident de voiture à 30 ans. Depuis, elle dit : « Je suis devenue un robot. Je fonctionne. Je gère. Mais je ne sens plus grand chose. C’est comme si on avait éteint un interrupteur. »
Piste n°3 : La génétique et le cerveau
Il existe aussi une composante génétique et neurobiologique à l’alexithymie.
Certaines études montrent une anomalie au niveau de l’insula, cette partie du cerveau impliquée dans la reconnaissance des émotions et l’empathie. Une libération limitée de sérotonine (le neurotransmetteur du bien-être) peut aussi expliquer les symptômes.
Tu n’as pas choisi d’être comme ça. Ton cerveau fonctionne différemment.
Les symptômes cachés : comment l’alexithymie sabote ta vie
Tu confonds tout
Fatigue ou tristesse ? Tu ne sais pas.
Colère ou peur ? Impossible à dire.
Anxiété ou simple accélération du cœur ? Tu te demandes encore.
Comme le dit Sifneos : tu ne parviens pas à distinguer tes sentiments de tes sensations corporelles. Alors tu décris sans fin tes symptômes physiques : « J’ai mal au ventre », « J’ai chaud », « Je suis fatigué·e ». Tu tentes d’exprimer des sentiments que tu ne peux pas élaborer.
Tu vis en mode « survie rationnelle »
Tu es hyper-logique. Concret·e. Pragmatique. Tu as une pensée opératoire : tu fonctionnes, tu agis, tu résous. Mais tu ne ressens pas.
Ta vie imaginaire est limitée. Tes rêves sont rares ou très logiques et rationnels. Tu n’as pas d’accès à la rêverie, à l’introspection.
Nietzsche dirait que tu es dans un exil de toi-même : « Deviens qui tu es. » Mais comment devenir qui tu es quand tu ne sais même pas ce que tu ressens ?
Tu somatises en silence
Les troubles psychosomatiques sont ta signature : eczéma, hypertension, troubles alimentaires, problèmes digestifs, migraines. Ton corps parle à ta place. Il crie ce que tu ne peux pas dire.
Comme l’explique Olivier Luminet : « Ces personnes, en souffrance, sont souvent mal comprises et ont souvent du mal à avoir des liens sociaux. »
Tes relations en pâtissent
On te reproche ton manque d’empathie. Ton insensibilité apparente. Ton isolement social.
Tu parles peu. Tu es perçu·e comme « trop sérieux·se ». Tu limites tes interactions. Pas par choix. Par incapacité à déchiffrer ce qui se passe chez l’autre… et chez toi.
Marc, 49 ans, divorcé deux fois, m’a dit un jour : « On me disait que j’étais froid. Distant. Mais je ne comprenais pas ce qu’on me reprochait. Je pensais que j’étais normal. »
Les comorbidités s’accumulent
L’alexithymie ne vient jamais seule. Elle traîne souvent avec elle :
- Dépression (50% des cas)
- Anxiété et troubles anxieux
- Trouble de stress post-traumatique (TSPT)
- Addictions (alcool, substances, 40-80%)
- Troubles alimentaires (23% à 77% chez les femmes)
- Troubles du spectre autistique (environ 50% des personnes autistes sont alexithymiques)
- Trouble de la personnalité borderline
Une étude récente (2024) a identifié deux sous-types d’alexithymie, dont un (le sous-type B) encore plus sévère, associé à davantage de symptômes dépressifs et anxieux.
Comment mener l’enquête sur toi-même (sans te perdre en route)
1. Pose-toi THE question : « Suis-je alexithymique ? »
Il existe un outil de mesure fiable : la Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). Un questionnaire d’auto-évaluation qui mesure trois dimensions :
- Difficulté à identifier ses émotions
- Difficulté à décrire ses émotions
- Pensée orientée vers l’extérieur (plutôt que vers l’intérieur)
Tu peux le passer en ligne. Gratuitement. C’est un point de départ.
2. Apprends à reconnecter le corps et l’esprit
Olivier Luminet recommande de commencer par observer ton rythme cardiaque.
Remarque quand il s’accélère. Dans quelles situations ? Avec quelles personnes ? Explore les possibilités de ce que ça pourrait signifier.
Ne cherche pas à tout comprendre tout de suite. Observe. Recueille des indices.
3. Enrichis ton vocabulaire émotionnel
Tu n’as pas les mots ? Apprends-les.
Utilise un lexique des émotions. La roue des émotions de Plutchik. Des listes. Des synonymes.
Au début, tu ne sauras pas. Mais à force de nommer, tu finiras par reconnaître.
4. Fais-toi accompagner (sérieusement)
L’alexithymie ne se règle pas seul·e dans ton coin.
La psychoéducation (comprendre ce qui t’arrive) est essentielle. La thérapie corporelle peut t’aider à reconnecter avec tes sensations. L’hypnose aussi. Certaines approches comme l’EMDR (pour l’alexithymie post-traumatique) peuvent dénouer ce qui s’est figé.
Graeme Taylor, chercheur référent sur l’alexithymie, le dit : il faut un accompagnement spécifique. Pas un coaching générique. Un vrai travail thérapeutique.
5. Accepte que ce soit long (et que c’est OK)
L’alexithymie primaire (le trait de personnalité) ne disparaît pas. Elle se travaille. Elle s’apprivoise. Tu apprends à composer avec.
L’alexithymie secondaire (post-traumatique) peut disparaître après traitement du trauma. Mais ça prend du temps.
Comme disait Spinoza : « La sagesse n’est pas de prier, mais de comprendre et d’accepter. »
Ce qui change quand tu arrêtes de te mentir
Tu cesses de confondre fatigue et dépression
Tu comprends enfin que ce vide permanent, ce n’est pas juste de la fatigue chronique. C’est peut-être de la tristesse non identifiée. De la colère refoulée. De l’angoisse diffuse.
Nommer, c’est déjà sortir du brouillard.
Tu retrouves un lien avec les autres
Quand tu commences à identifier tes émotions, tu deviens capable d’empathie. Pas par magie. Par apprentissage.
Marc Brackett (chercheur au Yale Centre for Emotional Intelligence) l’affirme : « Il est impossible de comprendre les émotions des autres sans d’abord comprendre les nôtres. »
Tu cesses de somatiser à outrance
Quand tu mets des mots sur ce qui te traverse, ton corps n’a plus besoin de parler à ta place. Les migraines s’espacent. L’eczéma se calme. Les troubles digestifs s’apaisent.
Pas instantanément. Mais progressivement.
Tu te retrouves
Tu n’es pas « guéri·e ». Mais tu n’es plus étranger·ère à toi-même.
Tu sais enfin que ce nœud dans le ventre, c’est de la peur. Que cette tension dans les épaules, c’est de la colère. Que ce vide, c’est de la tristesse non pleurée.
Et à partir de là, tu peux enfin agir.
Un dernier mot (avant de fermer le dossier)
Tu pensais juste être « fatigué·e ». « Distant·e ». « Pas très expressif·ve ».
Mais en vérité, tu vis avec une déconnexion émotionnelle chronique.
95% des personnes qui viennent me voir sont bloquées ou hésitantes. Beaucoup ne savent pas qu’elles sont alexithymiques. Elles pensent juste qu’elles « fonctionnent différemment ». Qu’elles sont « plus rationnelles ». Qu’elles « gèrent bien ». Mais gérer, ce n’est pas vivre.
L’alexithymie n’est pas une fatalité. C’est un point de départ. Une enquête à mener. Sur toi. Avec toi.
Tu ne sais plus ce que tu ressens ? Normal. Mais tu peux réapprendre.
Pas en forçant. Pas en te battant contre toi-même. En écoutant. En nommant. En accueillant.
Si tu veux mener cette enquête avec quelqu’un qui comprend ce brouillard, qui sait écouter sans juger, qui pose les bonnes questions sans te brusquer, je suis là.
Bienvenue dans l’enquête. Celle où tu retrouves enfin la langue de tes propres émotions.