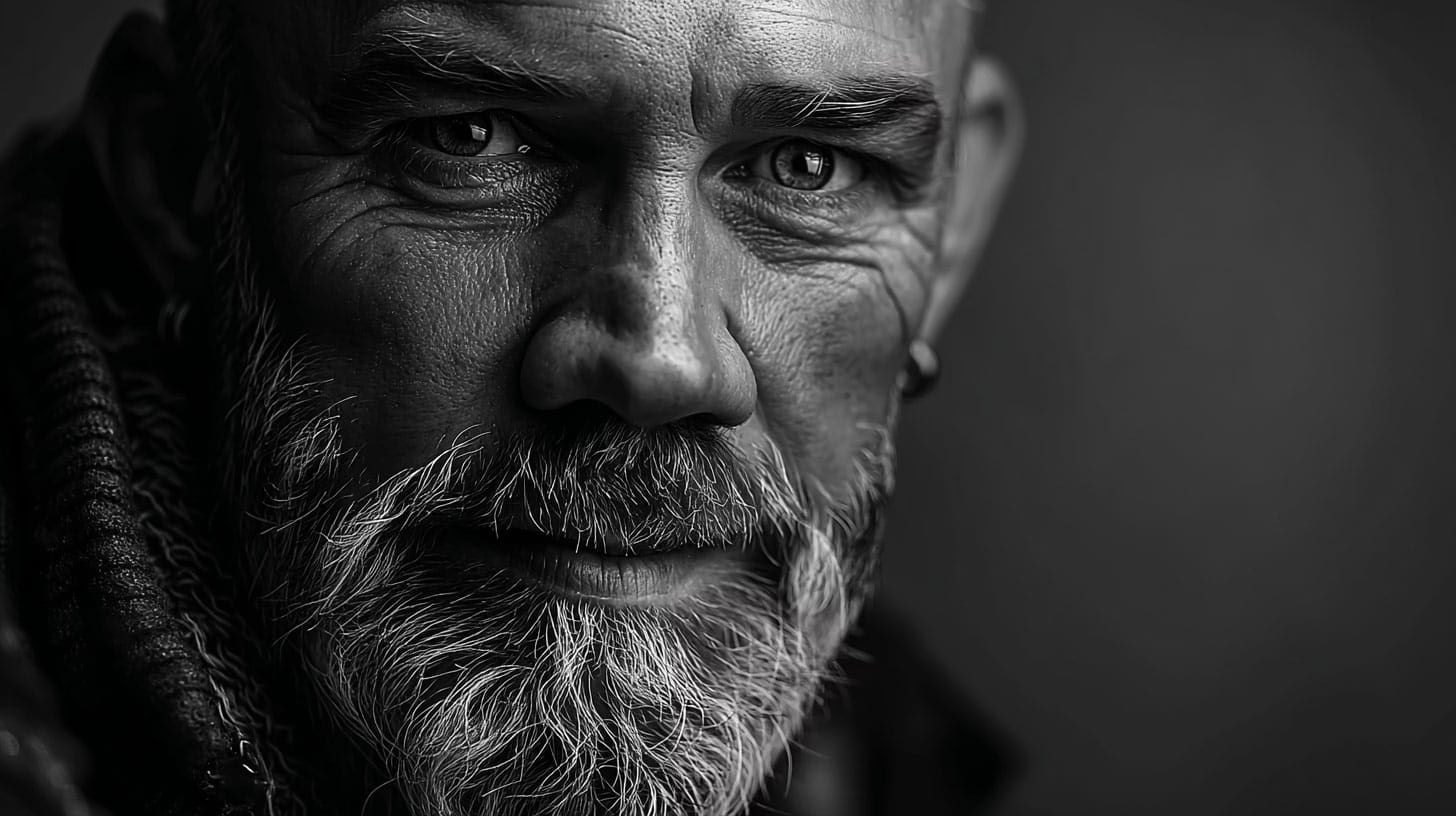A quel âge commencent-ils à catégoriser ?
On aime croire que les enfants sont « innocents », qu’ils ne voient ni la couleur, ni le genre, ni la différence. Mais c’est faux. Dès le plus jeune âge, un enfant catégorise, trie, hiérarchise. Il apprend à nommer, à reconnaître, à classer — et avec cela, viennent aussi les stéréotypes.
Ce n’est pas parce qu’il est méchant ou intolérant. C’est parce que son cerveau apprend à toute vitesse, et que la société lui donne des modèles prêts à l’emploi.
Dans cet article, on va voir à quel âge ça commence, comment ça fonctionne, et ce que tu peux faire en tant que parent ou éducateur pour limiter les dégâts.
1. Catégoriser, c’est apprendre : un mécanisme cognitif précoce
🧠 Dès 2 ans, l’enfant repère les différences visibles
Le cerveau d’un enfant est une éponge. Entre 0 et 6 ans, il absorbe tout ce qui l’entoure pour se construire une carte mentale du monde.
Et très tôt, il repère les différences :
- de genre : « les garçons font ci, les filles font ça »
- de couleur de peau : « elle est marron, lui est rose »
- de corpulence, d’âge, de statut social, de langue, etc.
Vers 2 ans, il commence à dire :
- « C’est pour les filles » / « C’est pour les garçons »
- « Il est noir » / « Elle est blanche »
- « C’est un vieux monsieur » / « Elle est une dame »
Ce n’est pas du racisme ni du sexisme. C’est de la classification.
Mais le problème, c’est ce qu’on colle comme valeur derrière ces classes.
À activer dès maintenant :
- Quand ton enfant remarque une différence, ne panique pas. Demande-lui ce qu’il en pense.
- Pose-lui une vraie question : Et tu crois que ça change quoi, qu’il soit comme ça ?
2. Entre 3 et 6 ans : l’âge d’or des stéréotypes
🎭 L’enfant cherche à comprendre le monde… en le simplifiant
Entre 3 et 6 ans, l’enfant développe ce que Piaget appelait la pensée intuitive et égocentrée. Il comprend le monde par catégories très rigides, avec peu de nuance.
Exemples fréquents :
- « Les filles aiment le rose. »
- « Les garçons sont forts. »
- « Les papas travaillent, les mamans s’occupent des enfants. »
- « Les gens qui parlent pas comme nous, ils sont bizarres. »
Ces idées viennent :
- des dessins animés et livres
- de ce qu’il voit chez ses parents
- de l’école, des amis, des pubs
- et surtout, du non-verbal des adultes (qui tient la porte, qui rit, qui fait quoi, qui décide…)
Le cerveau classe tout ça pour créer un cadre rassurant.
Mais attention : plus le stéréotype est renforcé, plus l’enfant s’y conforme ou en souffre s’il ne s’y reconnaît pas.
C’est à cet âge qu’une fille qui aime grimper aux arbres peut commencer à croire qu’elle « n’est pas normale ». Ou qu’un garçon sensible peut se dire qu’il est « faible ».
3. Que faire, alors ? Éduquer sans mentir, guider sans figer
🛠️ Comment les parents peuvent casser les clichés sans culpabiliser
Tu ne pourras pas empêcher ton enfant d’absorber des stéréotypes. Mais tu peux les désamorcer, les questionner, ouvrir des possibles.
✔️ 1. Montre-lui la diversité… dès le début
Des livres avec des héros non-blancs, des filles fortes, des garçons tendres, des familles non traditionnelles.
Des jeux variés, pas genrés. Des films intelligents.
✔️ 2. Sois un modèle de nuance
Au lieu de dire « C’est faux », demande-lui :
Tu crois que c’est toujours comme ça ? Tu connais des gens différents ?
Apprends-lui qu’il peut penser par lui-même.
✔️ 3. Corrige sans culpabiliser
S’il dit une phrase stéréotypée, ne le gronde pas. Il explore.
Tu peux répondre : Certains pensent ça, mais regarde, il y a plein d’exemples différents.
Montre-lui qu’il a le droit de changer d’avis.
✔️ 4. Valorise les contre-exemples
Parle des femmes astronautes, des hommes infirmiers, des héros noirs, gros, âgés, handicapés, etc.
Et surtout, donne-lui des modèles qu’il peut admirer sans tomber dans le cliché.
Conclusion
Les enfants ne naissent pas racistes, sexistes ou élitistes.
Mais ils naissent câblés pour catégoriser. Et la société, très vite, leur fournit des étiquettes toutes faites.
Le rôle d’un parent ou d’un éducateur, ce n’est pas de tout contrôler. C’est d’accompagner l’enfant dans sa découverte du monde sans le laisser enfermer ce monde dans des cases rigides.
Tu ne peux pas l’empêcher de voir les différences.
Mais tu peux lui apprendre à ne pas en faire des barrières.