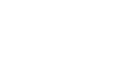Comment se forme l’attachement dans l’enfance ?
Le rôle du parent, du manque et de la cohérence émotionnelle
On ne naît pas confiant. On le devient.
Ce sentiment de sécurité intérieure, cette capacité à aimer sans peur ni dépendance, prend racine dans les toutes premières années de la vie — bien avant les mots.
L’attachement se forme à travers une danse silencieuse entre l’enfant et son parent : regards, gestes, voix, régularité.
C’est dans cette cohérence émotionnelle, ou son absence, que se dessine la manière dont on aimera plus tard.
Le tout premier lien : la base de tout
Dès la naissance, l’enfant dépend totalement de l’adulte pour sa survie. Mais il ne cherche pas seulement à être nourri : il cherche à être senti.
Quand un parent prend son bébé dans ses bras, le berce, répond à ses pleurs, il ne fait pas “que” rassurer. Il programme son cerveau émotionnel.
Le psychologue John Bowlby, fondateur de la théorie de l’attachement, l’expliquait ainsi : l’enfant développe une “base de sécurité” à partir de la constance de la réponse parentale.
Si l’adulte est fiable, stable, attentif, l’enfant apprend qu’il peut se tourner vers lui sans crainte. Il intègre alors que le monde est sûr, que l’amour est possible, que ses besoins ont de la valeur.
Mais si la réponse du parent est incohérente, froide ou imprévisible, le cerveau enregistre un autre message : “Je ne suis pas en sécurité. Je dois me méfier.”
Et ce simple décalage peut marquer toute une vie.
Le rôle de la cohérence émotionnelle
Ce que l’enfant ressent, plus que ce qu’il comprend
Un parent n’a pas besoin d’être parfait — il a besoin d’être cohérent.
C’est-à-dire d’offrir à son enfant une réponse émotionnelle stable : pas toujours joyeuse, mais lisible.
Un parent qui pleure, mais qui nomme sa tristesse (“Maman est fatiguée, mais tout va bien pour toi”) n’abîme pas son enfant. Au contraire : il lui apprend que les émotions peuvent être ressenties, exprimées et digérées.
Mais un parent qui dissimule, qui change brutalement d’humeur, ou qui rejette les émotions (“Ne pleure pas, ce n’est rien”) crée une confusion : le monde devient imprévisible, les émotions deviennent dangereuses.
L’enfant, pour survivre, s’adapte.
Certains deviennent hypervigilants, d’autres se coupent de leurs besoins. Certains apprennent à séduire, à anticiper, à se rendre invisibles. Tous cherchent, à leur manière, une cohérence émotionnelle manquante.
“Ce n’est pas l’événement qui blesse, mais l’absence de regard bienveillant pour le traverser.” – Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et éthologue
Quand le manque s’installe : les blessures invisibles
Le manque d’attention ou de présence ne se traduit pas toujours en cris ou en coups.
Il s’inscrit dans des gestes absents : un regard fuyant, une parole distraite, une émotion non accueillie.
L’enfant, lui, n’a pas la maturité pour se dire : “Mon parent est fatigué, il fait ce qu’il peut.”
Alors il fait ce que tous les enfants font : il se croit responsable.
Il intègre la croyance qu’il doit mériter l’amour, qu’il faut être sage, performant, drôle, utile pour être regardé.
Ce conditionnement devient une stratégie de survie.
Mais en grandissant, il se transforme en mode relationnel : la peur du rejet, le besoin d’approbation, la difficulté à poser des limites, tout cela vient souvent de ce vide affectif initial.
Spinoza l’écrivait déjà : « C’est l’esprit qui décide de ce qui est inquiétant ou désirable, et c’est lui seul qu’il faut changer. »
Mais avant de changer, il faut comprendre comment il s’est formé.
Ce que l’enfant apprend du parent : le miroir intérieur
Chaque parent enseigne, sans le vouloir, comment réguler une émotion.
- Quand il apaise un chagrin, il apprend à l’enfant que la peur n’est pas une fin.
- Quand il accueille la colère sans la juger, il lui montre qu’on peut exister sans nuire.
- Quand il reconnaît son erreur, il lui enseigne la réparation.
Mais quand il nie, dévalorise ou punit l’émotion, l’enfant apprend l’inverse :
- que ressentir est dangereux,
- que pleurer est honteux,
- qu’aimer, c’est risquer de souffrir.
Et l’adulte qu’il devient porte alors ce modèle intérieur. Il reproduit les gestes, les silences, les peurs — ou il lutte contre, avec la même intensité.
L’attachement, c’est donc moins une question d’amour que de répétition émotionnelle.
Réparer le lien : rien n’est figé
La bonne nouvelle : ce qui s’est construit peut se transformer.
L’attachement n’est pas un destin. C’est un apprentissage que l’on peut rééduquer.
En travaillant sur ses émotions, en apprenant à se sécuriser soi-même, en fréquentant des relations stables et bienveillantes, on reprogramme son système nerveux.
On redécouvre la sécurité intérieure.
C’est ce qu’appelle la psychologue Sue Johnson “l’attachement adulte réparateur” : réapprendre à se sentir en sécurité avec quelqu’un qui ne fuit pas, ne juge pas, ne trahit pas.
Cela demande du temps, de la conscience, et souvent de l’aide. Mais c’est possible.
Parce qu’à tout âge, le cerveau reste plastique. Et le cœur, réceptif à la tendresse.
“L’amour n’est pas un état, c’est une construction lente, cohérente, réciproque.” – Levinas
En résumé
L’attachement se forme dans les premières années à travers la présence, la cohérence et la fiabilité émotionnelle du parent. Le manque, lui, crée des failles — mais aussi une quête : celle d’un lien vrai, d’une sécurité intérieure qu’on peut reconstruire.