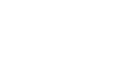Le désir est-il toujours égoïste ?
On entend souvent que le désir serait une force égoïste, centrée sur la satisfaction immédiate de nos manques. Mais est-ce si simple ? Levinas nous rappelle que le désir peut aussi être ouverture à l’autre, un appel à dépasser son propre horizon. Adler, lui, voyait dans le désir de contribuer une clé essentielle de la santé psychologique. Autrement dit : le désir n’est pas condamné à l’isolement, il peut être ce qui nous relie à plus grand que nous.
1. Quand le désir est repli sur soi
La logique du manque
Nietzsche l’avait déjà noté : nous aimons souvent le désir plus que l’objet désiré. Le risque est de réduire l’autre ou la chose désirée à un instrument pour combler un vide intérieur. Ici, le désir est une quête de possession. C’est le « je veux parce que ça me manque » – un mouvement qui tourne en rond, centré sur soi.
- On désire réussir pour briller, mais pas forcément pour contribuer.
- On désire être aimé, mais parfois seulement pour se rassurer.
- On désire consommer, et l’objet perd sa valeur dès qu’il est obtenu.
Ce cercle du manque nourrit frustration et insatisfaction : plus on obtient, plus on réalise que ça ne suffit pas. Spinoza parlait d’ailleurs d’une tristesse qui suit toujours la jouissance.
2. Le désir comme ouverture à l’autre
Levinas et le visage de l’autre
Pour Levinas, le vrai désir ne se réduit pas à la possession, il est désir de l’autre comme altérité. Non pas l’autre qu’on consomme, mais l’autre qu’on accueille. « Le sens de la vie est dans le visage de l’autre », écrit-il.
Ici, le désir devient une relation qui élargit. Je ne cherche pas seulement ma satisfaction, je cherche la rencontre. Dans ce cadre :
- Désirer l’autre, c’est reconnaître son mystère, pas le réduire.
- Désirer apprendre, c’est se laisser transformer, pas juste stocker des savoirs.
- Désirer contribuer, c’est donner sans attendre un retour immédiat.
C’est exactement ce que montre Adler : le désir de contribuer au bien-être d’autrui est une source de sens durable.
3. Le désir comme force communautaire
Quand le désir nous dépasse
Nos histoires de vie le prouvent. Christine, l’une de mes clientes, a longtemps vécu pour les autres, au point de s’oublier. Mais quand elle a commencé à désirer exister pour elle-même, ce n’était pas contre les autres. C’était pour être plus vraie dans ses liens.
Le désir peut donc être :
- une force d’ancrage : quand il nous relie à ce qui compte vraiment.
- une force de transmission : quand il nourrit les générations, les projets communs.
- une force de résilience : quand il nous pousse à nous relever non pas pour nous seuls, mais pour inspirer et soutenir autour de nous.
Comme le dit Adler, « le sens de la vie est de contribuer au bien-être des autres ». Ce n’est pas l’abolition de l’égo, mais sa transformation.
4. Désir, communauté et transformation
Une responsabilité partagée
Le désir est ambigu : il peut enfermer ou relier. Mais ce n’est pas une fatalité. On peut l’orienter. En prendre la responsabilité. C’est même là qu’il devient moteur de transformation.
- Égoïste, le désir s’épuise vite.
- Ouvert, il devient une énergie durable.
- Partagé, il tisse des liens de confiance, de solidarité, d’humanité.
En fin de compte, le désir n’est pas toujours égoïste. Il peut être la racine même de notre appartenance au monde. Levinas nous invite à voir l’autre comme une révélation, Adler comme une mission de contribution. Le désir peut être le chemin par lequel je me découvre relié à plus vaste que moi.